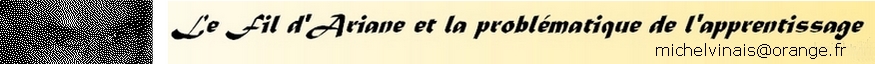
La pensée, ses contenus, ses contenants.
(Cf. B. Gibello)
Rappel clinique.
|
Les
travaux poursuivis depuis une dizaine d'années avec l'équipe du
laboratoire de la Salpêtrière ont permis à B.Gibello de découvrir
des troubles singuliers de l'intelligence et de la pensée, non répertoriés
jusque là.
L'équipe
de BG se trouvait devant des résultats d'examen inattendus et très
surprenants. En effet, ils avaient l'habitude de croire à une forte
corrélation entre niveau des capacités intellectuelles, et la maturation
des processus cognitifs et logiques à un âge donné. Après avoir
soigneusement vérifié les examens pratiqués et aussi après avoir
rencontré d'autres cas semblables, ils furent amener à réviser leurs
croyances, et à découvrir que dans certains cas, capacités intellectuelles
et maturation cognitivo-intellectuelle se trouvaient disjointes. |
1. Questions de nosographies.
2. Si on revenait sur les inhibitions intellectuelles :
|
Il
est manifeste que les quatre variétés classiques de troubles de
l'intelligence ne recouvrent pas les R O R ni les D C P. Pour des
raisons diverses, beaucoup de cliniciens ont pris l'habitude de
désigner et de considérer ces troubles comme des inhibitions intellectuelles.
Cette habitude est fâcheuse, puisque par définition, dans les inhibitions
intellectuelles, le développement des processus cognitivo-intellectuels
s'est fait normalement alors que pour les R O R et les D C P, il
s'agit de dysgénèse de ces mêmes processus. |
3. Les Dysharmonies cognitives pathologiques (DCP)
| Elles touchent certainement au moins 3 à 4% de la population d'enfant d'âge scolaire, 10 à 30% des sujets traumatisés du crâne. Elles se caractérisent chez un sujet donné par la coexistence de processus de pensée et de raisonnement normaux dans certains secteurs, avec dans certains autres secteurs, des altérations graves de ces mêmes processus. Chez les sujets adultes, on constate la dégradation de processus acquis, et chez les enfants, leur retard du développement. |
4. Les retards d'organisation du raisonnement (ROR)
| Ils constituent la forme complète de la symptomatologie des retards d'organisation du raisonnement. Il s'agit de sujet dont les capacités intellectuelles n'apparaissent pas atteintes, en ce sens qu'ils ne se comportent pas comme des débiles mentaux, et que les tests de capacité intellectuelle (QI) ne montrent pas de déficit. Cependant, ils raisonnent avec des structures de raisonnement très archaïques pour leur âge, et leurs compétences practo-gnosiques sont généralement fort médiocres, contrastant avec des capacités d'expression verbale sensiblement normales. Ces sujets ont probablement été autrefois isolés cliniquement sans être situés dans une classification heuristique, par l'aliéniste Chaslin au siècle dernier sous le nom de "sots", par le professeur Zazzo sous le nom de "débiles à Q.I normaux" il y a une vingtaine d'années. On peut distinguer les retards et les régressions d'organisation du raisonnement, respectivement chez des enfants et des adultes ou des vieillards. |
Contenants et contenus de pensée
1. Distinguer les capacités intellectuelles et l'organisation de la pensée.
|
L'existence
même des DCP et des ROR met en évidence la nécessité de distinguer
les capacités intellectuelles de l'organisation des processus cognitivo-intellectuels. |
2. Contenant de pensée
| Les
contenus de pensée sont faits de ces représentations psychiques :
perception et émotions hic et nunc, souvenirs évoqués, projets et
anticipations. Nous sommes généralement inconscients de ce que ces contenus de pensée ont sens pour nous seulement par l'effet de contenants de pensée. Les contenants de pensée les plus anciennement connus sont les processus praxiques et gnosiques, qui, donnant sens aux perceptions sensorielles ou aux séquences motrices nous permettent de reconnaître l'objet perçu ou de choisir le mouvement à réaliser dans un certain but. Le langage constitue un autre contenant de pensée ; depuis longtemps, les linguistes nous ont montré qu'un mot dans un discours ou un texte prend sens par effet de contexte, par les liens paradigmatiques et syntagmatiques qu'il noue avec d'autres mots. Ils nous ont aussi montré qu'il en va de même pour les monèmes, ces fragments de mots porteurs d'une signification élémentaire, comme par exemple en français les préfixes "a" ou "in" ou les suffixes "ements" ou "tions". En l'absence de contenant linguistique, la forme sonore ou visuelle des mots peut être perçue, mais non leur sens, comme nous en faisons l'expérience en écoutant parler une langue inconnue. Quand le contenant linguistique n'a pas été constitué, on se trouve devant ce que la clinique neurologique nomme "audi-mutité". Quand il a été perdu, on observe les aphasies, les surdités ou les cécités verbales, au cours desquelles les mots vus ou entendus restent lettres mortes. De même, les contenants de pensée cognitifs, relatifs par exemple à l'espace, au temps, à la logique donnent sens aux contenus de pensée correspondant. La psychologie génétique nous montre combien les contenants de pensée cognitifs évoluent avec l'âge, faisant par exemple passer notre conception de l'espace d'une axiomatique quasi-topologique à une axiomatique euclidienne, ou encore notre conception du temps d'un temps circulaire à un temps historique. Enfin la représentation que nous avons de nous-mêmes, dans ses différentes appellations : schéma corporel, image de soi, self, objet narcissique, se construit-elle à partir de ce qu'Anzieu désigne sous le nom d'enveloppes psychiques, fonction contenante primordiale : le "Moi Peau". BG propose comme définition générale des contenants de pensée l'univers psychique dans lequel des contenus de pensée peuvent : - apparaître - prendre sens - être compris, par soi même et par les autres - et être communiqués. Un contenu de pensée est indéterminé, insignifiant, "élément bêta" au sens W. Bion, tant qu'il n'a pas été pris dans un ou plusieurs contenants de pensée qui l'aient transformé en "élément alpha". BG considère que l'altération ou la dysgénèse des contenants de pensée se manifeste par : - la négligence de certaines perceptions, ou le caractère "insignifiant" de celle-ci, ou encore leur compréhension fragmentaire, syncrétique. Ces négligences ou insignifiances sont à l'origine de nombreuses difficultés d'apprentissage, tant sociaux que scolaires ou professionnels. - Les oublis ou altérations de souvenirs, ainsi que de graves difficultés, voire une impossibilité d'apprendre par l'expérience. - La difficulté ou l'impossibilité d'anticiper des événements ou d'évoquer correctement des chronologies. - Les troubles de la personnalité où prédominent les anomalies des représentations de soi, et l'impression d'être "mal dans sa peau". - Des troubles du langage, de la logique, des dysgnosies et des dyspraxies. - &Etant entendu que ces symptômes coexistent dans la plupart des cas. L'observation générale que le trouble commun aux ROR et aux DCP était l'incapacité à donner un sens à des contenus de pensées banalement compris par les sujets normaux a donc amené à opposer aux contenus de pensée (perceptions, affects, souvenirs, fantaisies) les contenants de pensée. Dans cette perspective, les contenants de pensée sont les processus dynamiques par lesquels prennent sens les contenus de pensée. On connaît depuis le siècle dernier les processus practo-gnosiques, qui précisément donnent sens à des perceptions sensitivo-sensorielles, ou à des séquences motrices. Ces processus constituent une partie seulement des contenants de pensée. Schématiquement, on peut considérer comme contenants de pensée les contenants de pensées cognitifs, qui comprennent les gnosies et les praxies, l'organisation du raisonnement. Il s'ajoute à ces contenants cognitifs ceux constitués par le langage, le fantasme inconscient au sens Freudien, et le système narcissique de représentation de soi. Il convient probablement d'y adjoindre des contenants collectifs, tels que la tradition familiale, la culture, etc. |
3.Contenus de pensée et genèse des contenants de pensée.
| Ce
qui peut être présent, élaboré, à notre conscience à un moment, ce
peut être un souvenir précis, complet, une citation de poésie mais
aussi quelque chose de flou, de vague, un mouvement émotionnel, sentiment
de malaise ou de bien être corporel, et des quantités d'autres choses
qui nous passent par la tête, occupent notre pensée sans que nous
y donnions forcément un sens. Un sens est donné à ces contenus de pensée par les processus que sont les Contenants de pensée. Ils mettent en forme, donnent une signification aux contenus, peuvent également remettre en forme des contenus passés pour redonner une nouvelle signification. (On peut après coup réaliser que ce à quoi on avait cru auparavant est faux : par exemple, on élabore ses connaissances, ses représentations au fur et à mesure que les contenants de pensée deviennent de plus en plus puissants, capables de faire des modifications, associations d'idées, corrélations diverses.) A propos de l'évolution de ces capacités de comprendre et de donner sens à ce qui arrive, il faut dire un mot du concept important qui est celui de "mémoire de travail" (working mémory). La mémoire de travail c'est la petite quantité de mémoire qui est à notre disposition pour prendre conscience de l'instant. Exemple : lors d'une conférence, "votre" mémoire de travail qui est occupée par les sons fabriqués avec la bouche, transmis par le micro, est occupée aussi par la perception de l'environnement mais ceci n'est pas très important car l'environnement ne bouge pas, elle est peut être occupée par le confort ou l'inconfort des chaises, par un malaise que vous avez... Cette mémoire de travail se représente par "ce dont nous avons conscience à un instant donné". C'est une mémoire de faible capacité et c'est à travers cette faible capacité que se font les échanges entre notre psychique et le reste. La mémoire de travail à une durée d'à peu près 2 secondes. Si on détourne notre attention de quelque chose, notre mémoire se dégage et on peut se centrer sur autre chose. On ne peut penser simultanément à plus de 7 choses (l'empan mnésique varie de 2 à 7), 7 objets et quand on pense à 7 objets et qu'on est capable de les manipuler individuellement c'est qu'on est déjà très fort. Cette notion de mémoire de travail, il est important de savoir qu'elle est la même chez le bébé de quelques jours que chez le vieillard. La capacité de la mémoire de travail ne varie guère à travers l'existence ce qui varie par contre c'est l'habileté avec laquelle on peut grouper les éléments de manière à ce qu'ils forment un ensemble et ne soient plus seulement 5 ou 6 objets isolés. Exemple : dans un premier temps, nous sommes capables de mémoriser 7 chiffres, et au fur et à mesure que nous augmentons nos connaissances en mathématique, nous sommes capables quand nous avons bien travaillé, de regrouper l'ensemble des naturels dans l'ensemble N ce qui fait 1 seul objet à la place d'une infinité. Ceci est le regroupement et cela nous permet de penser d'une façon plus complexe. Cette notion de mémoire de travail et cette notion que ce qui change c'est l'organisation que nous pouvons faire des connaissances que nous avons sont une donnée tout à fait fondamentale qui a révolutionné les conceptions et théories de Piaget. Piaget pensait en effet l'inverse : qu'il y avait une modification des structures au sens des structures de mémoire et d'attention et on sait aujourd'hui que les structures de mémoire ne sont pas changeables et que par contre, c'est la capacité à concentrer l'information qui change. La théorie de Piaget sur le plan de la théorie abstraite a été totalement révisée mais il faut savoir aussi que le schéma général que Piaget avait repéré d'évolution du raisonnement et des processus cognitifs en plusieurs stades a toujours quelque chose de valable. Après cette parenthèse sur la mémoire, revenons au sujet. Les contenants
de pensée donnent sens, donne forme, permettent de comprendre des
contenus. a) les contenants archaïques |
3. 1 Les contenants de pensée archaïques
| Ce
sont ceux du bébé. Certains pensent qu'ils se forment
très tôt, dès la naissance à mon avis.
Jusqu'à présent, même si on a pu vérifier
si c'est dès la naissance, c'est de toute façon très
tôt que le bébé est muni de ces contenants de
pensées archaïques. Ces contenants de pensées archaïques sont au nombre de trois : Contenant de pensée cognitifs Contenants de pensée fantasmatiques un 3ème groupe est constitué par les contenants de pensée narcissiques Le processus du marquage sexuel :Ce premier type est représenté par ce que Freud a décrit sous le nom de fantasme originel. Ces fantasmes originels, ce sont des structures psychiques qui ont la propriété de mettre en forme et de donner sens à nos excitations sexuelles.On ne sait pas vraiment comment le bébé pense ses expériences d'excitation des zones érogènes mais vous et moi nous pensons quand nous avons un émoi sexuel en terme de séduction, puis il y a quelque chose qui passe dans le registre du fantasme de castration, de frustration et plus loin de frigidité, d'impuissance. Le 3ème élément met en forme les émois sexuels qui nous passent par la tête et nous avons une représentation de ce que nous pourrions faire dans l'intimité. Freud dit que c'est le fantasme de scène primitive (une représentation du coït parental qui constitue un modèle). Ces trois fantasmes originels - fantasme de séduction - fantasme de castration - fantasme de scène primitive sont les premiers éléments, premiers contenants de pensée qui vont donner sens à ces émois sexuels. Du moins c'est ce que Freud pensait, et que ça s'arrêtait là. Or, depuis, on sait qu'il y a en 4ème type de fantasme qui intervient et en particulier chez les enfants handicapés, c'est le fantasme d'auto-engendrement. C'est le fantasme de s'être fait soi-même, de s'être engendré soi-même. Cela paraît quelque chose d'inventé par des psychanalystes fous or cela court les rues, du moins les contes et les mythes : - L'oiseau phoenix qui renaît de ses cendres est une forme d'auto-engendrement. - Les vampires sont des natures qui s'auto-engendrent. Ce fantasme est important en pathologie mentale mais c'est aussi un fantasme banal normal que l'on rencontre chez les enfants. De nombreux enfants pensent être nés avant leurs parents. Ces quatre fantasmes originels sont la pierre de touche de ce qui pourra ensuite donner naissance à des troubles pathologiques du type des psychoses, névroses… Freud a expliqué dans un article célèbre comment la pensée ainsi constituée souffrait de points faibles, susceptibles de perturber gravement son fonctionnement. Cette conception rend compte de la constitution et du développement de l'objet libidinal. Marquage épistémophilique :
Une des premières catégorisations est de distinguer les objets suçables des objets non suçables. De la même manière, il y a les objets qu'on peut suivre du regard et ceux qu'on ne peut pas…De la même manière, il y a les objets que l'on peut prendre, taper, cogner, secouer et ceux qu'on ne peut pas… Dans
les premiers temps de la vie de l'enfant, il est extrêmement
occupé à découvrir ce qu'il peut faire sur
le monde et à en tirer des conséquences et des observations
importantes. Alors que le domaine de la sexualité et le domaine du fantasme vont se développer dans un domaine où le bébé ne l'est pas, dans un domaine où il est dans une situation d'impuissance. Car
probablement l'un des critères les plus déterminants
: quand on est capable de réaliser quelque chose, on le
fait. Quand le bébé est compétent, il fait son truc, quand il ne l'est plus, il organise des fantaisies dans sa tête : ce que, avec les psychologues cliniciens, on nomme, le processus "primaire". Les contenants de pensée narcissiquesCe sont ceux qui s'occupent de donner un sens aux représentations que nous avons de nous-mêmes. Pour ces contenants de pensée, il est plus difficile que les précédents de se rendre compte de leur importance et de leur réalité. Exemples tirés de la pathologie montrant que ces contenants sont importants dans l'organisation de la pensée : - Un sujet amputé d'un membre : il arrive souvent que la personne ait l'illusion que le membre existe, qu'il le sente, il perçoit un membre fantôme. Cette notion de membre fantôme est quelque chose qui fonctionne anormalement chez le sujet amputé mais qui est quelque chose qui est de l'ordre de ses contenants de pensée narcissiques. - Autre exemple d'inter-action des contenants narcissiques : le syndrome d'Anton Babinsky. C'est le cas d'un hémiplégique avec lésion du cerveau non dominant qui peut parler et qui crie que quelqu'un veut le pousser hors du lit, prendre sa place ou même que quelqu'un lui fait des propositions. Il ressent un intrus dans son lit. Ce malade ne reconnaît plus comme lui appartenant la moitié paralysée de son corps. Or nous, nous avons une idée de notre corps qui est constituée, nous avons une idée de notre posture…mais il est surprenant de voir que lorsque ce contenant de pensée narcissique ne marche plus normalement, on a des impressions, des illusions, des symptômes. Mais ces contenants de pensée narcissiques qui donnent une forme et un sens à ce que nous ressentons de notre corps, de notre identité, ils existent d'une façon moins dramatique : - Exemple : quand on se sent bien ou mal dans sa peau, - Quand on est à l'aise, quand aussi on entend comme un double avec qui on discute. La plupart des gens se parlent de temps en temps. - Ceci fait partie de ce qui est mis en forme par les contenants de pensée narcissiques. Ces 3 types de contenants de pensée aboutissent aux alentours du 6ème mois de la vie de l'enfant jusqu'à environ la 12ème année, à lui permettre de constituer tout un ensemble de représentations psychiques, de construire tout un ensemble de connaissances à partir des expériences vécues. Tout
un tas de représentations psychiques, liées les unes
aux autres par des liens associatifs, des liens d'analogie, de continuité,
de contiguïté dans l'espace et le temps. |
3. 2 Le contenant de pensée langagier
|
C'est-à-dire
que le bébé apprend à nommer avec des mots,
des images qu'il a en tête. a)
D'une part, dans le langage, il y a entre les mots des liens associatifs
en plus, des liens associatifs qui sont entre les images stockées. b)
D'autre part, le langage permet d'accéder à l'expérience
d'autrui. Les
représentations psychiques langagières sont différentes
des représentations psychiques archaïques en ce sens
: Grâce
au langage, je peux construire de nouvelles représentations
que je n'ai pas expérimentées moi-même. Ce
contenant de pensée langagier est très puissant, très efficace
: |
3.3 Contenants de pensée culturels, sociaux, groupaux
|
Ces
contenants de pensée sont multiples. Cet ensemble de positions se superpose aux contenants de pensée antérieurs pour amplifier, souligner ou supprimer certains effets. D'autre part chaque culture va promouvoir un certain nombre de représentations culturelles ou spirituelles qui vont être utilisées pour penser. Finalement,
les contenants de pensée groupaux ont la propriété
d'engendrer des illusions. Cette illusion "groupale" a d'autres cousins : illusions contagieuses culturelles et ces illusions vont modifier les représentations psychiques que nous avons et imprimer un certain nombre de choses nouvelles qui ne sont pas forcément de notre expérience. Exemple
: une variété d'illusion groupale : le racisme.
|
4.Évolution des troubles des contenants de pensée (TCP)
| En l'absence de traitement adéquat, on observe assez souvent une évolution continue assez souvent une évolution continue et progressivement aggravée dès TCP. On rencontre en effet fréquemment des enfants présentant initialement une DCP, se transformant ultérieurement en ROR, et parfois ensuite en une débilité mentale. Une évolution similaire peut être retrouvée chez les sujets d'intelligence normale initiale en effet, on constate l'apparition d'une DCP, à laquelle peut succéder une régression globale de l'organisation du raisonnement pour aboutir dans un troisième temps à un tableau clinique de démence. |
5. Gravités des troubles des contenants de pensée.
|
Ces
troubles constituent des atteintes graves : Leurs
conséquences sont extrêmement sévères,
car ils perturbent très considérablement les possibilités
de socialisation des enfants. Habituellement, les sujets présentant
des TCP ne dépassent pas le niveau d'une classe de CM1 et
il s'avèrent incapables d'acquérir une compétence
professionnelle quelconque. |
6. Causes des troubles des contenants de pensée
|
Les
causes des TCP apparaissent multiples. |
Conclusions
|
Intérêt de la notion de trouble des contenants de pensée. La notion de contenant de pensée apparaît comme particulièrement intéressante dans les domaines ci-après : Intérêt dans le domaine psychopathologique cliniqueen
psychopathologie infantile : Intérêt dans le domaine de l'éducation, de la rééducation et de la pédagogiechez
les enfants et adolescents en échec scolaire, Intérêt en regard des découvertes récentes sur les conditions de la mémorisationNos connaissances relatives à la mémoire, aux conditions de mémorisation, et aux processus d'apprentissages ont été bouleversées par diverses découvertes récentes. En particulier, les travaux de Mischkine et Appenzeller ont mis en évidence la nécessité de distinguer une mémoire "d'habitudes", à expression essentiellement motrice, renforcée par les répétitions, et une mémoire de significations, telles que seules les perceptions ayant pris sens et connotations émotionnelles sont mémorisées. Pour cette forme de mémoire, les réitérations sont inutiles, le sens saisi une fois étant correctement mémorisé. La notion de contenant de pensée rend compte de cet effet de sens nécessaire à la mémorisation. Approches thérapeutiquesIl ne saurait être question dans le temps limité de cet exposé de décrire en détail les moyens thérapeutiques développés dans le cadre de mon laboratoire à l'Hôpital de la Salpêtrière. Je me contenterai de donner une esquisse des voies d'approche que nous explorons. Cinq
pistes semblent actuellement particulièrement prometteuses
: D'une manière générale, la perspective des Troubles des Contenants de pensée nous amène à reconsidérer les processus d'apprentissage, d'acquisition de connaissances, de prise de sens et de conscience, ainsi que les déficits de ces fonctions : pertes de mémoire, dysmnésies, échecs et pertes d'apprentissages et la pathologie de leur constitution. Cette remise en question des notions classiques débouche sur des innovations multiples tant sur le plan clinique que thérapeutique, éducatif et pédagogique. Elle conduit également, dans une perspective intégrée de la psychopathologie, à proposer diverses modifications de la théorie psychanalytique classique afin d'y faire une place à l'objet épistémique et aux contenants de pensée. |
(CR à partir des conférences avril 89 et février 92)
Pour aller plus loin :
• GIBELLO, Bernard/ LEBOVICI, Serge. Préf : "L'enfant à l'intelligence troublée : nouvelles perspectives cliniques et thérapeutiques en psychopathologie cognitive"
Paris : Le Centurion, 1984. 226 p.
• GIBELLO, Bernard : " La pensée décontenancée : essai sur la pensée et ses perturbations" Bayard, 1995. 287 p.
• Les ouvrages de B. Douet
• BERGER, Maurice : "Les troubles du développement cognitif : approche thérapeutique chez l'enfant et l'adolescent" Privat, 1992.
| Accueil |
Contacts
|
|
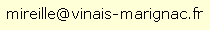 |
©Tous droits réservés - Michel Vinais -
|
©
Copyright 2007-2026 https://vinais-marignac.fr
|